LE PRETRE IMAGE DU CHRIST, SERVITEUR OBEISSANT
Ces quelques idées que je vais présenter ici n’ont aucune prétention intellectuelle. Il ne s’agit pas d’une étude, mais plutôt d’une méditation personnelle, d’un partage. Je ne suis pas théologien systématicien pour aborder les questions d’ecclésiologie ou de christologie que le thème de ce jour pourrait évoquer. Je suis plutôt moraliste éthicien qui se pose la question : comment faire pour bien faire ? Je fais partie de ces Jésuites à l’intelligence ordinaire, mais qui croit dur comme fer aux valeurs fondamentales de la vie religieuse, sans lesquelles toutes nos prétentions ne seraient que feu de paille. Toutefois, mon expérience d’abord de laïc engagé dans la vie active, ayant servi l’Etat de Côte d’ivoire comme cadre informaticien dans un établissement paraétatique de la place et, ensuite d’un jésuite qui, depuis 23 ans, vit l’aventure de la vie religieuse, ma permet aujourd’hui d’affirmer l’importance tant en milieu civil qu’en milieu religieux.
Vous avez désiré que j’ouvre une réflexion sur notre être prêtre image du Christ, serviteur obéissant. J’avoue que le projet est ambitieux, car il s’agit de nous inviter à être image du Christ, celui qui cette semaine va remplir l’imaginaire et la foi de plus d’un milliard de Chrétiens. En réalité, cette image est une mosaïque d’images pales ou éclairées. Peu importe, pourvu que l’on fasse partie du corps de la mosaïque pour refléter le Christ. Ainsi, je voudrais comprendre notre être prêtre comme communion nécessaire à l’image du Christ. Puisque c’est lui que nous voulons refléter, il s’agit pour nous de nous engager sur un chemin de communion. Comment parvenir à la communion nécessaire qui fera advenir en nous l’image du Christ ? C’est à cela que j’entreprends humblement de répondre.
Je voudrais, dans un premier temps, regarder avec vous le jeu de pouvoir qui peut naître de la contestation en suggérant que l’on peut s’en sortir pour autant que nous admettons une procédure de représentation. Dans un second temps, m’appuyant sur le modèle du Christ obéissant, je considère la relation évêque et prêtre dans un diocèse comme quête de la volonté de Dieu par la mise en disposition de soi-même à l’autre, prêtre ou évêque. Dans un troisième temps, je spécifie cette mise à disposition par la capacité à l’écoute mutuelle. Je dis en substance que le prêtre et l’évêque sont appelés à écouter la voix de l’esprit. Ici, je fais une incise provocatrice en rappelant qu’il en va ainsi dans nos traditions africaines. Enfin, je souligne quelques difficultés qui peuvent naître de notre refus de vivre la communion comme serviteur obéissant.
POUVOIR DE LA CONTESTATION VERSUS CHARITE DE LA REPRESENTATION
Le monde du travail est hiérarchiquement organisé. Le chef est chef d’un groupe de subalternes qui lui doivent obéissance dans l’exercice de leur profession. Quoique la contestation y est légitime, les agents subalternes contestent dans le cadre organisé du syndicat. Remarquons que l’idée des syndicats fut l’émanation de la réflexion catholique au 19ème siècle devant l’exploitation des ouvriers. On a alors voulu qu’en face du pouvoir des riches propriétaires et industriels il y ait un pouvoir qui soutienne les revendications des pauvres ouvriers. Les syndicats sont nés dans le but de légitimer les revendications des ouvriers exploités dans un contexte d’opposition des pouvoirs. Dans les activités ordinaires d’une entreprise, l’obéissance est de rigueur afin de maintenir l’ordre et d’atténuer les conflits. L’obéissance y est fonctionnelle ; elle sert à réguler les pouvoirs. L’obéissance religieuse est plus que fonctionnelle ; elle sert à réguler les pouvoirs. L’obéissance religieuse est plus que fonctionnelle. Elle exprime d’abord une relation filiale et une relation de communion. J’ajouterai, en fils de St Ignace, que l’obéissance indique une relation de coopération dans le discernement.
St Ignace le fondateur des jésuites disait : « Si les franciscains se distinguent par la pauvreté, les dominicains par la prédication, que les compagnons de Jésus excellent dans l’obéissance ». la dernière congrégation générale de la Compagnie de Jésus, la 35è du genre depuis la fondation de l’ordre, tenue à Rome en 2008, invite justement à l’approfondissement du vœu d’obéissance chez les jésuites. On a souvent compris l’obéissance chez les Jésuites comme un acte servile que pose le sujet qui n’a aucun droit, qui agit comme un cadavre privé de volonté, de désir et de liberté. Il n’en est pas ainsi. Pour St Ignace, sentire cum ecclesia constitue un impératif majeur, un acte de foi qui invite à voir au-delà des événements le dessein de Dieu qui s’accomplit, qu’il s’agit pour le sujet comme pour son responsable de rechercher en toute sérénité. C’est pourquoi, pour les jésuites, « chercher et trouver Dieu en toute chose » constitue l’acte religieux le plus fondamental. Cet acte religieux met en jeu le discernement du supérieur et celui du sujet à la recherche de la volonté de Dieu.
Ainsi Ignace admet ce qu’il appelle la représentation, c’est-à-dire la capacité à porter à la connaissance de celui qui décide les fruits de sa prière et de son propre discernement sur une question qui affecte l’individu personnellement, quelqu’un d’autre ou plusieurs autres personnes. Cela, tout en restant libre de la décision finale qui en résulterait. Une telle approche n’est nullement de la contestation, mais la participation au discernement de la volonté de Dieu. Il présume que l’on a accueilli la décision de celui qui a le droit de décider. Il présuppose que ce dernier n’a pas toute la vérité puisqu’il s’agit de la volonté de Dieu que nulle ne peut saisir dans sa totalité.
Partant, la représentation s’oppose à la contestation en ce qu’elle n’est pas de l’ordre de l’opposition des pouvoirs mais celui de la charité. C’est mû par la charité qu’un individu fait une représentation. Il participe à la justesse de la décision en apportant un éclairage qui lui est propre pour bien comprendre la volonté de Dieu sur la décision à prendre.
Il faut reconnaître qu’aujourd’hui, la contestation que fait surgir une opposition de pouvoirs fait son entrée par la grande porte de l’Eglise. Nous nous laissons facilement prendre dans le jeu mondain de l’opposition des pouvoirs, en nous constituant en syndicalistes revendicateurs de quelques intérêts. Le pape Benoît XVI le rappelait le 12 mars dernier à l’université Pontificale du Latran, lorsqu’il s’adressait aux participants du Congrès théologique. Il disait ceci en substance : « Le prêtre doit être attentif à ne pas se laisser attirer par la mentalité dominante qui tend à dissocier la valeur du ministre de sa fonction et non à son existence. » Il est vrai, nous sommes bien de notre époque, dans une Afrique qui aspire à plus de démocratie, à plus de participation aux décisions, mais souffrant de la mal gouvernance, de la gestion opaque du bien commun et de la confiscation des libertés. Cette contradiction dans le vécu socio-polique de nos nations devrait nous alerter et nous donner à réaffirmer plutôt notre appartenance ontologique à Dieu et le caractère suérminemment autre du modèle de la vie sacerdotale que nous poursuivons. Je me demande alors quel est le modèle qui devra guider notre action ? Est-ce le modèle mondain de l’opposition – contestation qui en appelle à la lutte des pouvoirs ou la représentation qui, en charité, invite à considérer d’autres aspects de la réalité afin d’aboutir à une décision juste, transparente, nécessaire et admissible pour tous ?
A SUIVRE
- 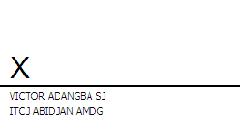
[1] URS Von BALTHASAR.- les grands textes sur le Christ, coll. « jésus et jésus-Christ » n° 50, (Paris, Desclée, 1991), p. 158-161

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire