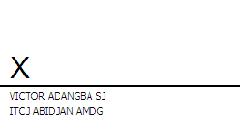1.3. LA SOLIDARITE SELON L’ENSEIGNEMENT DE L’EGLISE (suite)
1.3.1. LA SOLIDARITE SELON LES PERRES DE L’EGLISE (suite)
A) SAINT BASILE 330-379
Evêque de Césarée, Basile prononce en 368_369, les homélies sur la situation sociale et la répartition inégale des biens. « Efface le péché originel en distribuant de la nourriture[1]. » « Songe ! Ô riche, à ton bienfaiteur, souvins-toi de toi-même, rappelle-toi qui tu es, quels biens tu administres, qui te les a confiés et quelles raisons t’ont préférer à tant d’autres. Tu es le serviteur du Dieu Saint, l’économe de tes compagnons d’esclavage. Ne crois pas tous les avantages destinés à ton ventre. Traite les biens que tu as entre les mains comme s’ils appartenaient à autrui : quelques temps ils te charment, puis ils s’évanouiront et l’on t’en demandera un compte détaillé[2] ».
B) SAINT GREGOIRE DE NYSSE 332-395
Ce saint dénonce le luxe des palais et surtout les excès de table. »La maison est en fête, commente Grégoire. Cependant des milliers de Lazare se présentent à sa porte. Les uns se traînent péniblement, ceux-ci privés d’yeux, ceux-là amputés de leurs pieds. Certains rampent littéralement, mutilés de tous leurs membres. Ils crient, et ne sont pas entendus : là-haut sifflent les flûtes, montent les chansons, claquent les rives braillardes. S’ils frappent un peu fort à la porte, le portier d’un maître barbare bondit comme une brute et les chasse à coups de bâton, en les traitant de chiens impudents et son fouet cingle leurs ulcères. Ils reculent alors les amis de jésus, qui incarnent le commandement essentiel, sans avoir eu droit à une bouchée de pain, mais rassasiés d’injures et de coups. Et dans le tripot de Mammon, on recrache son repas comme un vaisseau trop chargé, on dort sur les tables, auprès des coupes. Maison de honte, où le péché porte deux noms : ribotes d’ivrognes, fringale des pauvres que l’on a chassés[3]. »
C) SAINT AUGUSTIN 354-430
Evêque d’Hippone de 395 à 430, « Augustin voit sa conversion et ses appels à la prêtrise et à l’épiscopat comme un appel de Dieu à vivre l’amour. C’est d’abord avec ses clercs qu’il veut expérimenter une vie d’amitié, de communion profonde et concrète, faite de toute sorte de partage et de sollicitude fraternelle[4]. »
« Avant tout, vivez unanimes à la maison, ayant une seule âme et un seul cœur, tournés vers Dieu. N’est-ce pas la raison même de votre rassemblement ? Et puis qu’on n’entende pas parler parmi vous de biens personnels, mais qu’au contraire tout soit en commun[5] . » En s’appuyant sur le passage de l’Apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens[6], Augustin insiste sur la solidarité dans le corps du Christ.
« Jésus-Christ ne fait en effet qu’un seul homme, avec sa tête et son corps, sauveur du corps et membres du corps, deux dans une seule chair, et dans une seule voix et dans une seule passion et, quand l’iniquité aura pris fin dans un seul repos[7]. »
1.4 LA SOLIDARITE SELON LE CONCILE VATICAN II
Le sens profond de la solidarité s’exprime dans l’acte créateur de Dieu : en façonnant l’homme et la femme, Dieu a voulu que les deux vivent dans une solidarité mutuelle. D’après Gaudium et Spes (G.S.)[8], Dieu a créé les hommes, non pour vivre en solitaires, mais pour qu’ils s’unissent en société…De par sa nature, l’homme est donc appelé en vivre en société. C’est dans sa relation avec les autres qu’il peut se réaliser pleinement. C’est grâce aux autres qu’il fait valoir ses talents et apprécie le sens de la vie. Comme le déclare si bien G.S. sans relation avec autrui, il ne peut vivre, ni développer ses qualités. C’est donc en étant solidaire avec les autres que l’homme découvre le bonheur, et adhère progressivement au vrai bonheur. Et ce bonheur, c’est jésus, le Verbe de Dieu Incarné, qui le révèle à l’homme. G.S. l’explique encore clairement, en déclarant que le mystère du verbe Incarné…Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation.
Par son incarnation, le Christ s’est fait solidaire de l’humanité entière en partageant pleinement notre condition, excepté le péché. Il s’est fait l’un de nous. Il est devenu véritablement homme. Et selon les expressions de G.S., par son incarnation, le fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Désormais, avec le Christ, tous les hommes sont appelés à vivre solidaires les uns avec les autres. En se soumettant volontairement et librement aux limites humaines et aux intempéries de la nature, le Christ a voulu épouser totalement la condition humaine en vue de révéler à l’homme l’amour de Dieu. Selon G.S. le Verbe Incarné en personne a voulu entrer dans le jeu de cette solidarité. Il a pris part aux noces de Cana ; il s’est invité chez Zachée, il a mangé avec les publicains et les pécheurs. C’est en évoquant les réalités les plus ordinaires de la vie sociale, en se servant des mots et des images de l’existence la plus quotidienne qu’il a révélé aux hommes, l’amour du Père et la magnificence de leur vocation.
Ense faisant solidaire des hommes, le Christ a voulu considérer et rendre surnaturelles, les relations humaines. L’unité des enfants de Dieu était sa préoccupation première. Comme le père et lui ne font qu’un, il a voulu que tous les hommes soient un. C’est sans doute dans ce sens que G.S déclare que dans sa prédication, il a clairement affirmé que les fils de Dieu aient l’obligation de se comporter entre eux comme des frères. Dans sa prière, il a demandé que tous ses disciples soient « un ».
En définitive, de par leur nature, les hommes sont appelés à vivre solidaires les uns des autres ; Dieu a créé les hommes pour qu’ils vivent unis et soient sauvés. De même que Dieu a créé les hommes, non pour vivre seuls, mais en solidaire (…), de même il lui a plu aussi de sanctifier et de sauver les hommes, non pas isolément, il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait, selon la vérité et le servirait dans la sainteté[9].
1.5 LA SOLIDARITE DANS L’ENSEIGNEMENT DU PAPE JEAN-PAUL II
Pour le Pape Jean-Paul II, tout chrétien doit passer de l’interdépendance à la solidarité, c’est-à-dire à cette « détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c’est-à-dire pour le bien de tous et de chacun, parce que tous, nous sommes vraiment responsables de tous. Une telle détermination est fondée sur la ferme conviction que le développement intégral est entravé par le désir de profit et la soif de pouvoir. Ces attitudes et ces « structures de péché » ne peuvent être vaincus que par une attitude diamétralement opposée : se dépenser pour le bien du prochain en étant prêt, au sens évangélique du terme, à « perdre » pour l’autre, au lieu de l’exploiter et à le servir au lieu de l’opprimer.
La pratique de la solidarité à l’intérieur de toute société est pleinement valable, lorsque ses membres se reconnaissent les uns les autres comme des personnes. Ceux qui ont plus de poids disposant d’une part plus grande de biens et de services communs, devraient se sentir responsables des plus faibles et être prêts à partager avec eux, ce qu’ils possèdent. De leur côté, les plus faibles, dans la même ligne de la solidarité, ne devraient pas adopter une attitude purement passive ou destructive du tissu social mais, tout en défendant leurs droits légitimes, faire ce qui leur revient pour le bien être de tous.
La solidarité nous aide à voir « l’autre » personne, peuple, ou nation, non comme un instrument quelconque dont on exploite à peu de frais la capacité de travail, et la résistance physique pour l’abandonner quand il ne sert plus, mais comme notre « semblable », une aide, que l’on doit faire participer, à parité avec nous, au banquet de la vie auquel tous les hommes sont également invités par Dieu.
La solidarité que nous proposons est le chemin de la paix et en même temps du développement, la paix est le fruit de la solidarité. A la lumière de la foi, la solidarité tend à se déposséder elle-même, à prendre les dimensions spécifiquement chrétiennes de la réconciliation. Alors le prochain n’est pas seulement un être humain avec ses droits et son égalité fondamentale à l’égard de tous, mais il devient l’image vivante de Dieu le Père, rachetée par le sang du Christ et objet de l’action constante de l’Esprit Saint.
Alors la conscience de la paternité commune de Dieu, de la fraternité de tous les hommes dans le Christ, « fils dans le fils », de la présence et de l’action vivifiante, donnera à notre regard sur le monde comme un nouveau critère d’interprétation. Au-delà des liens humains et naturels, déjà si forts et si étroits, il se profile à la lumière de la foi un nouveau modèle d’unité du genre humain dont doit s’inspirer en dernier ressort la solidarité. Ce modèle d’unité suprême, reflet de la vie intime de Diue un en tris personnes, est ce que nous chrétiens désignons par le mot « communion ».
La solidarité doit donc contribuer à la réalisation de ce dessein divin, tant sur le plan individuel que sur celui de la société nationale et internationale[10]. »
2. DE LA SOLIDARITE DANS L’EGLISE A PARTIR DE LA FRACTURE SOCIALE IVOIRIENNE
Ce qui apparaît dans ces lignes ne sont que des hypothèses de recherches, donc discutables. La crise ivoirienne que nous voyons à travers la fracture du pays autour d’une ligne qui part de Bouaké, entre une partie gouvernementale et une partie non gouvernementale, est la résultante d’un fossé qui s’est creusé dans la société ivoirienne depuis 1990 . Je partirai donc d’un regard sur l’université, et ensuite sur la structuration de la société ivoirienne à travers l’accès à l’éducation et la santé. Puis je montrerai la déchirure de la société ivoirienne dans l’écroulement des piliers (au niveau politique, religieux), puis je terminerai par la crise laïque mondiale et la société ivoirienne en déliquescence.
2.1. A L’ORIGINE DE LA FRACTURE, LA CRISE UNIVERSITAIRE
En 1981, la commission d’orientation de l’université avait orienté dans les filières littéraires (philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie), en plus des 20 étudiants habituels, orientés boursiers, 20 autres étudiants dont la liste portait la mention ONB. Il faut dire qu’à l’époque, le slogan « l’avenir appartient à la science et à la technique » faisait ses ravages. Le gouvernement de l’époque ne voulait pas avoir maille à partir avec des contestataires. Lorsqu’après un mois de cours, il fallait partir toucher sa bourse, c’est en ce moment que les ONB ont compris ce que ce sigle voulait dire « orientés non boursiers. » ; la plupart des ONB était des enfants de parents pauvres. L’injustice fut tellement flagrante qu’un effort de solidarité est né au même moment parmi les étudiants boursiers. La première aide est allée aux étudiants de médecine qui faisait pitié car ils devaient faire 7 années d’étude sans bourse. Il semble que cet effort de solidarité n’a pas été compris par les étudiants eux-mêmes. Beaucoup ont refusé cette aide qu’ils jugeaient insuffisante. Mais la flèche de l’Etat avait réussi à divisé les étudiants. Les ONB ont été marginalisé, fichés par la sécurité. Certains ont reçu des menaces d’exclusion s’il y avait un quelconque soulèvement sur les campus. Le projet du gouvernement était de supprimer la bourse complètement des étudiants. Pour y parvenir briser la solidarité des étudiants. La deuxième année, même scénario et l’année d’après même chose. Les étudiants isolés devenant de plus en plus nombreux, ne s’étant plus montré solidaires, n’avaient plus les moyens et la volonté de lutter. L’Etat ayant gagné une première bataille et décidé d’étendre la guerre aux enseignants eux-mêmes ; c’est ainsi qu’en 1990, il y a eu le salaire à double vitesse parmi les enseignants : deux docteurs ayant le même grade mais dont l’un percevait la moitié du salaire de l’autre. Cette autre mesure injuste a vidé les enseignants de leur lieu naturel, l’université, pour les offres plus alléchantes. Le terrain était propice pour mettre à exécution le plan de balkanisation de la société : mettre en place les universités privées.
La fracture sociale s’est faite par rapport à l’accès à l’éducation. Deux lycéens d’un même pays passant le même baccalauréat mais ne prenant plus après les résultats le chemin de la même université. Lun allant dans une université ivoiro-canadienne, et l’autre l’université de Cocody. L’un passant des diplômes crédibles et l’autre des diplômes non crédibles, obtenus après des cours incertains et douteux. L’un ayant un travail bien rémunéré qui l’attend après la formation et l’autre venant grossir le nombre des chômeurs. C’est ce groupe de mécontents diplômés et sans emploi qui iront grossir les cellules socialistes et marxistes en Europe et plus tard prendront les armes pour renverser le pouvoir en place et rétablir la dictature du prolétariat.
Au niveau de la santé également les ivoiriens n’auront pas un égal accès aux soins de santé. Les plus nantis iront se soignés dans les cliniques privés tandis que les plus pauvres auront que les hôpitaux publics pour se soigner, pire aux guérisseurs traditionnels ou simplement à la rue. Un petit pays ou même les médecins sont au chômage alors que la population n’a pas accès aux soins.
Tandis qu’un ami universitaire me confiait pendant la guerre, qu’il ne trouvait plus de yaourt fruité pour son épouse européen et ses enfants métis, d’autres ivoiriens n’ont qu’un repas par jour, la mort subite, ou à un semblant de repas sans viande, ni condiments. Certains se ravitaillent aux supermarchés et d’autres au marché gouro tout simplement. On pourrait continuer de disserter sur les différents fissures de la société ivoirienne, qu’on a tous négligé de colmater et aujourd’hui tout cela est devenu un gouffre béant. Mais intéressons-nous aussi à la destruction des colonnes.
2.2. LA DESTRUCTION DES COLONNES
La première colonne qui a été détruite c’est la colonne politique : Houphouet –Boigny qui l’avait symbolisé pendant plus de 4Oans, a été un record de longévité et un symbole fort de ralliement. On pouvait ne pas être d’accord avec lui, mais tous le respectait. Après sa mort, ceux qui l’ont remplacé n’ont pas eu le même aura. Au contraire, ils ont été tellement critiqués, qu’ils ne renvoient qu’à l’ombre d’eux-mêmes. On ne leur reconnaît aucune légitimité, aucun charisme car ils n’ont que des suiveurs. Chacun et son parti a détruit l’autre et son clan. Ils sont maintenant restés trois pistéléros qui attendent, la fin du film selon les propres termes de l’un d’entre eux. Mais pour qu’il y ait fin d’un western, il faut que le Brave tue le Chef bandit. Mais qui est le Brave ? Qui est le chef Bandit ?
La deuxième colonne est au niveau religieux. Tous les grands ensembles ont connu leurs secousses. L’eglise Catholique, avec le départ à la retraite du Cardinal Yago. Rome crée 4 Archevêchés et le nouveau Président de la Conférence est Auguste Nobou de Korhogo. Dès cet instant les Catholiques sont ballotés, ils ne savent plus qui est le chef véritable de leur église. Est-ce le cardinal Agré, qui venait d’être fait Cardinal entre temps ou bien Vital Yao le nouveau Président de la Conférence, Archevêque de Bouaké ? Il y a un problème de leadership. Et puis beaucoup de clergé se rajeunit. Les jeunes prêtres critiques parfois leurs évêques et refusent quelquefois les affectations qu’ils jugent arbitraires. Chez les méthodistes, même fissure. Entre les méthodistes unis et les méthodistes simples. Les chrétiens ne sont pas en reste avec Ediémou et Zagadou. Les Musulmans hésitent aussi entre le CSI et le CNI. Tandis que les grands groupes ne parlent pas d’une seule voix, d’autres petits groupes ont pignon sur rue et leur font une concurrence incroyable : les évangélistes essaiment, soutenus fortement par le nouveau pouvoir. Et la franc-maçonnerie a atteint son point culminant actuellement en Côte d’ivoire ; La force de ces nouvelles phratries c’est le dollar américain. Cela noua amène a abordé le dernier point.
2.3. LA CRISE MORALE MONDIALE ET SA REPERCUSSION SUR LA COTE D’IVOIRE
La crise de la Côte d’ivoire est d’abord et avant tout une crise spirituelle. L’argent est au fondement de la société ivoirienne et enfoui profondément dans le cœur des ivoiriens. Abidjan est aujourd’hui devenue la nouvelle Babylone. Tout se vend et se monnaie. Pour de l’argent, les ivoiriens sont prêts à tout. L’ivoirien est ouvert à tous les réseaux de la malhonnêteté. La magie mondiale hindoue ou autre a pignon sur rue en Côte d’Ivoire. Les religions orientales ont des adeptes ici et chacun y va à qui mieux mieux pour s’enrichir. L’argent facile circule. Je veux devenir riche quelque que soit la manière. On peut aller jusqu’à faire des sacrifices humains pourvu que je me maintienne au pouvoir. La dernière trouvaille des ivoiriens est de déféquer sur les jeunes filles pendant les rapports sexuels. Pédophiles et pédérastes pullulent dans la société, ainsi que les lesbiennes. Plus tu veux monter dans l’échelle sociale il faut être franc-maçon ou pédé. Les jeunes préfèrent être des stress-steaseuses que de s’habiller correctement. Les tournées à la rue princesse sont de véritables moments de dénudement. Les filles vous suivent si vous leur offrez une bouteille de bière. La franc-maçonnerie a atteint le cœur du pouvoir en Côte d’ivoire. « Le pouvoir est une véritable alchimie des contraires PDCI, FPI,RDR et Forces Nouvelles ». il ne nous reste plus que la voie de la prière et de la véritable conversion.
CONCLUSION
Chaque fois que nous prions sincèrement et exposons le St sacrement, l’Esprit malin n’est pas content et recule. Pour sauver la Côte d’ivoire, nous devons redoubler d’efforts. Quand à mon problème du départ, nous devons nous montrer solidaires. Beaucoup de jeunes gens et jeunes filles ont des diplômes et ne trouvent pas de travail, nous devons leur en donner. Le Christ nous dit « Doonez-leur vous-mêmes à manger ». Ne pas attendre que notre interlocuteur soit de la même ethnie, du même partie politique, de la même équipe de football pour l’aider. Il faut l’aider parce qu’il est fils et fille de Dieu, disciple du Christ. Alors pas de fausses promesses, pas de « do ut des », « du donnant donnant » mais seulement la gratuité dans le Christ qui nous as aimé et s’est livré pour nous.
Père AKE Patrice, Curé de St Jacques
[1] Homélie VII(contre les riches) cité par Bernadi, La prédication des Pères Cappadociens, (Paris, PUF 1968), p. 61
[2] Homélies sur St Luc, chap. 12,18, in Riches et Pauvres dans l’Eglise ancienne, lettres chrétiennes n° 6, (Paris, Grasset 1962), p. 193
[3] Sermon II sur l’amour des pauvres, in Riches et Pauvres dans l’Eglise ancienne lettres chrétiennes n° 6, (Paris, Grasset 1962), p. 146
[4] K. JOACHIM.- O.C., p. 59
[5] Sermon 356, 1-2, cités par jean-Paul II, Lettre apostolique sur St Augustin in Documentation Catholique du 5 Octobre 1986
[6] 1Co 12,26-27
[7] Saint Augustin.- Homélie sur le Ps 61, textes choisis et commentés par le Chanoine G. Humeau dans les plus belles homélies de St Augustin (Paris, Beauchesne 1942)
[8] G.S. n° 12.22.32
[9] G.S n° 9
[10] Jean-Paul II.- Pour un vrai développement lettre encyclique Sollicitudo Rei Socialis du 30 décembre 1987, p. 50-53