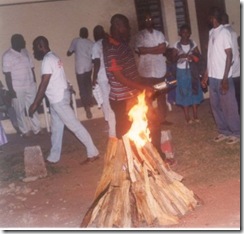GENEALOGIE NIETZSCHEENE DU CHRIST ET DES CHRETIENS(2)
1. LE CHRIST VU NIETZSCHE(Suite)
D’après l’Aurore de Nietzsche[1], un christianisme, probe et juste, a toujours analysé les écrits de ses exégètes avec perspicacité. Ceux-ci, que ce soit au niveau de la dogmatique ou encore au niveau de la science exégétique proprement dite, ne manquent pas d’audace, mais sont parfois dans l’embarras devant le caractère sacré de l’Ecriture. Cette argumentation qui ne tient pas la route, offusque le philologue Nietzsche qui s’insurge contre les prédicateurs protestants en relevant « la façon grossière dont (ceux-ci) exploite(nt) le fait que personne ne peut (leur) répondre, la manière dont (ils) déforme(nt) et accommode(nt) la bible[2]… »
Quel statut a l’Ancien Testament dans le judaïsme et dans le christianisme ? Pour les chrétiens, selon Nietzsche, partout dans l’Ancien Testament, il n’est question que du Christ et rien d’autre, alors que les Juifs ont une autre lecture. Par exemple, la croix est un symbole central chez les premiers, tandis que les autres ont d’autres symboles, comme le bois, la verge, l’échelle, le rameau…Tous ces derniers symboles, pense Nietzsche, ne renvoient pas tous au Christ exclusivement. Il va même narguer les interprétations christiques comme celles des bras étendus de Moïse, tout comme les lances où rôtissait l’Agneau pascal. N’est-ce pas les dérives de l’exégèse allégorique qui ont fait le bonheur des chrétiens, pendant un certain temps ?
Le fait de parler en images, nous voulons dire en paraboles, apparaît chez Nietzsche, comme une caractéristique propre du christianisme et du judaïsme. Dans le paysage judaïque, affirme-t-il, « un Jésus-Christ ne pouvait être possible[3]. » Ce paysage, Nietzsche le caricature « comme la sombre et sublime nuée d’orage de Jehova en colère.[4] » Ici, nous relevons deux choses : la nuée qui personnifie la présence de Dieu d’une part, et de l’autre, la colère de Dieu ; le dieu de l’Ancien Testament qui est présenté parfois comme le Dieu des armées, qui se met en colère parfois, de façon violente dans l’histoire et punit les pécheurs. Les adjectifs « sombre et sublime » expriment ce contraste entre la colère et les grandes œuvres de Dieu, qui sont sublimes. Pour ce maître de la métaphore qu’est Nietzsche, le Christ vient égayer le ciel obscur, « comme un miracle de l’amour, comme un rayon de la grâce la plus imméritée.[5] » Quelle belle pluie d’images ! Nietzsche voit le Christ comme « un rêve d’arc-en-ciel[6] » ; son incarnation comme « une échelle céleste sur laquelle Dieu descendait vers les hommes[7] » En un mot, il était l’exception dans cette grisaille.
Un autre texte majeur où Nietzsche parle du Christ, est tiré de l’Antéchrist[8] n°39. Il nous raconte la véritable histoire du Christianisme. Dans un passage précédent Nietzsche avait soutenu que le premier chrétien était St Paul. Ici, dans ce texte, il se rétracte pour affirmer qu’il n’y a eu qu’un seul chrétien, Jésus-Christ, et ce seul chrétien est mort sur la croix. Jésus est aux yeux de Nietzsche un évangile. Après lui, tout ce qui est appelé évangile est un dysangelium, un kataévangélium, une mauvaise nouvelle. Puis Nietzsche s’en prend à St Paul, l’auteur qui a fait du salut par la foi, le signe distinctif du chrétien. Nietzsche argumente, en nous disant que seul le Jésus-Christ a vécu en chrétien. Nous reviendrons sur cette affirmation qu’il n’y a jamais eu de chrétiens, quand nous aborderons la question de la généalogie nietzschéenne des chrétiens.
Dans le même ouvrage[9] au numéro 41, Nietzsche trouve absurde l’idée selon laquelle Dieu a donné son fils, en sacrifice, pour le pardon des péchés. L’idée de sacrifice, surtout du sacrifice expiatoire, est répugnante, selon notre généalogiste. Il s’agit pour lui d’une régression vers le paganisme. L’exégète Nietzsche dit que Jésus-Christ a aboli le péché, nié l’abîme entre Dieu et l’homme. Jésus-Christ est le seul qui ait vécu cette unicité entre Dieu et l’homme, et cela était une bonne nouvelle. En théologien, Nietzsche évacue de la question du salut, le jugement et la parousie, la mort par le sacrifice et la résurrection. Or, il semble que pour lui, la béatitude soit la seule réalité de l’évangile.
Après la lecture de ces textes majeurs sur la généalogie nietzschéenne du Christ, il nous reste à découvrir d’autres aspects de ce personnage unique, au travers de textes secondaires.
Nietzsche écrit dans un chapitre sur la vie religieuse d’Humain trop humain[10] I, que le Christ s’est pris pour le célèbre fondateur du christianisme, ou encore pour le fils de Dieu incarné, ou encore pour une personne exempte du péché. Ensuite Nietzsche affirme que l’Antiquité fourmille de fils de Dieu. Cette idée est, de nos jours, partagée par Paul Diel, quand il écrit : « Tout homme est symboliquement ‘fils de dieu’. Mais aucun homme et aucun dieu ne peut être à la fois dieu et entièrement homme. Même réellement existant, un Dieu tout puissant ne pourrait faire pareil miracle[11]. » Nietzsche et Diel sont d’accord pour affirmer qu’un homme-dieu ne peut être parfaitement homme, car, « un homme qui serait Dieu ne serait pas un homme comme tous les autres hommes[12]. »
Toujours dans Humain trop humain I, au chapitre intitulé « caractères de haute et basse civilisation », le Christ est vu, par Nietzsche, comme celui qui a freiné la production de la grande intelligence[13]. Nietzsche le voit aussi comme l’homme le plus noble[14], dans Humain trop humain I. Dans la seconde partie, au chapitre « opinions et sentences mêlées »au numéro 96, notre généalogiste parle du christianisme accompli qui consiste à réaliser la vertu et la perfection. Mais pour lui, le psychologue et le chrétien sont en désaccord pour qui concerne l’amour des ennemis. Pour Nietzsche, toutes les promesses du Christ telles que « soyez parfaits comme votre père céleste est parfait » ou encore celle-ci « la vie terrestre et une vie bienheureuse » sont des erreurs[15].
A propos de la justice terrestre, Nietzsche soutient que le fondateur du christianisme veut supprimer cette religion et « extirper du monde le jugement et la punition[16].» Si nous remontons à un texte au dessus, le Christ est présenté comme le plus pieux de tous les hommes, et a laissé échappé cette parole amère : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné [17]? » L’abandon du Christ semble une situation pleine d’amertume chez Nietzsche. Mais ce verset du Psaume n’est que le premier, et est un psaume plein de confiance ; le psalmiste finit dans la pleine confiance en Dieu : « Et tu m’as réponds et je proclame ton nom parmi mes frères, je te loue en pleine assemblée. »
A la page suivante, Nietzsche voit Jésus-Christ comme un Sauveur et un Médecin[18]. « Le fondateur du christianisme, écrit-il, est médecin de l’âme ». Il avait de graves défauts et de grands préjugés, ajoute-t-il. Il utilisait des méthodes brutales pour lutter contre le péché. Ensuite Nietzsche considère Socrate comme supérieur au Christ, le fondateur du christianisme, par « sa joyeuse façon d’être sérieux et par cette sagesse pleine espièglerie qui est le plus bel état d’âme de l’homme[19]. » Il est aussi plus intelligent, ajoute-t-il.
La vengeance chrétienne contre Rome est un chapitre d’Aurore, au livre premier, numéro 71. Nietzsche montre comment dans la généalogie des chrétiens, ceux-ci ont pris leur revanche sur les païens et, depuis Constantin, n’ont plus lâché prise. Le Messie que Nietzsche présente comme « le juif crucifié », « le symbole du salut », apparaît comme la plus profonde dérision, en face des préteurs romains[20]. Un peu plus loin, notre généalogiste revient à la charge dans le chapitre « la connaissance de celui qui souffre ». Au livre deuxième d’Aurore, Nietzsche pense que le Christ est clairvoyant sur lui-même[21]. Cette clairvoyance n’a pas empêché Nietzsche de commettre des erreurs.
Au livre troisième du Gai Savoir, au numéro 138, Nietzsche parle de l’erreur du Christ. Celle-ci consiste à soutenir que « rien ne faisait souffrir davantage les hommes que leurs péchés.[22] » Son erreur, c’est de se sentir sans péché. Nietzsche ajoute qu’il manquait d’expérience. Son âme d’être de pitié était un grand mal. Finalement au n° 140, Nietzsche reproche au Christ de n’avoir pas eu un sens assez subtil, car il était juif[23].
Fin de cette partie
Publié par Dr AKE Patrice Jean, ce 29 juin 2009 dans http://pakejean16.spaces.live.com à 19h16
[1] NIETZSCHE(Friedrich).- Aurore. Livre premier n° 84, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 1018
[2] NIETZSCHE(Friedrich).- Aurore. Livre premier n° 84, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 1018
[3] NIETZSCHE(Friedrich).- Le Gai Savoir. Livre troisième n° 137, dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 137
[4] NIETZSCHE(Friedrich).- Le Gai Savoir. Livre troisième n° 137, dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 137
[5] NIETZSCHE(Friedrich).- Le Gai Savoir. Livre troisième n° 137, dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 137
[6] NIETZSCHE(Friedrich).- Le Gai Savoir. Livre troisième n° 137, dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 137
[7] NIETZSCHE(Friedrich).- Le Gai Savoir. Livre troisième n° 137, dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 137
[8] NIETZSCHE(Friedrich).- L’Antéchrist n° 39 dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 1072
[9] NIETZSCHE(Friedrich).- L’Antéchrist n° 41 dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 1075
[10] NIETZSCHE(Friedrich).- Humain trop humain I, « la vie religieuse », n° 144, dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), pp. 524-525
[11] DIEL(Paul).- Le symbolisme dans la Bible. L’universalité du langage symbolique et sa signification psychologique. (Paris, Payot, 1975), p. 36
[12] DIEL(Paul).- Le symbolisme dans la Bible. L’universalité du langage symbolique et sa signification psychologique. (Paris, Payot, 1975), p. 36
[13] NIETZSCHE(Friedrich).- Humain trop humain I, « caractères de haute et basse civilisation », n° 235, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 567
[14] NIETZSCHE(Friedrich).- Humain trop humain II, Coup d’œil sur l’Etat n° 475, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 652
[15] NIETZSCHE(Friedrich).- Humain trop humain II, Opinions et sentences mêlées » n° 96, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 734
[16] NIETZSCHE(Friedrich).- Humain trop humain II, le voyageur et son ombre n° 81, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 865
[17] NIETZSCHE(Friedrich).- Humain trop humain II, le voyageur et son ombre n° 81, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 865
[18] NIETZSCHE(Friedrich).- Humain trop humain II, le voyageur et son ombre n° 83, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 866
[19] NIETZSCHE(Friedrich).- Humain trop humain II, le voyageur et son ombre n° 86, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 868
[20] NIETZSCHE(Friedrich).- Aurore, livre premier n° 71, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 1010
[21] NIETZSCHE(Friedrich).- Aurore, livre deuxième n° 114, dans Œuvres Complètes I, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 1037
[22] NIETZSCHE(Friedrich).- Aurore, livre troisième n° 138, dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 138
[23] NIETZSCHE(Friedrich).- Aurore, livre troisième n° 140, dans Œuvres Complètes II, (Paris, Robert Laffont 1993), p. 138